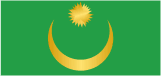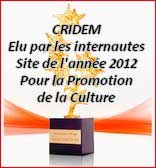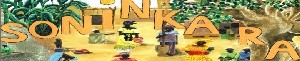08-08-2025 12:32 - Sahel–Cédéao : Les USA prônent un front commun pour la paix

Apanews -- Les États-Unis appellent à une coopération accrue pour la sécurisation régionale, entre l’Alliance des États du Sahel et la Cédéao , malgré les tensions qui ont conduit au départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l’organisation régionale.
La représentante américaine par intérim aux Nations Unies, Dorothy Shea, a lancé jeudi 7 août un appel pressant aux pays du Sahel et à leurs voisins côtiers pour qu’ils « dépassent leurs divergences » et s’unissent dans une lutte coordonnée contre le terrorisme, dans le respect de l’État de droit et des droits fondamentaux.
Condamnation ferme des attaques terroristes
Intervenant devant le Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une séance consacrée à la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest, l’ambassadrice Shea a dénoncé « avec la plus grande vigueur » les récentes offensives menées par plusieurs organisations terroristes actives dans la région : le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), l’État islamique au Sahel, l’État islamique en Afrique de l’Ouest et Boko Haram.
Cette intervention diplomatique survient alors que l’Afrique de l’Ouest traverse une période de fragmentation institutionnelle majeure. Trois nations sahéliennes – le Burkina Faso, le Mali et le Niger – ont rompu avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qu’elles accusent de complicité avec Paris dans des tentatives de déstabilisation.
Ces trois pays ont formé la Confédération des États du Sahel (AES), une nouvelle entité qui s’est rapidement structurée avec ses propres symboles : drapeau, logo, hymne national et autres emblèmes identitaires.
Des négociations en cours malgré les tensions
Toutefois, des signes encourageants émergent de cette crise diplomatique. Les deux blocs régionaux ont entamé un processus de négociation pour redéfinir leurs relations futures. Une première session de dialogue s’est déroulée en mai dans la capitale malienne, Bamako.
Début août, lors d’une rencontre à Freetown, le président sierra-léonais Julius Maada Bio, actuellement à la tête de la Cédéao, a encouragé le président de la Commission de l’organisation, Omar Alieu Touray, à intensifier les efforts de rapprochement avec l’AES.
L’ONU facilitatrice du dialogue régional
Dorothy Shea a salué l’action du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) dans son rôle de médiateur entre les parties, particulièrement sur les dossiers économiques, politiques et sécuritaires qui divisent la région.
La diplomate américaine a également tiré la sonnette d’alarme concernant l’impact déstabilisateur de la guerre civile au Soudan sur l’ensemble de la région. Elle a souligné les risques liés à la perméabilité croissante des frontières et à la circulation incontrôlée d’armes légères, facteurs qui menacent d’aggraver l’instabilité des États sahéliens.
Un appel urgent a été lancé aux factions soudanaises en conflit pour qu’elles cessent « sans délai » les hostilités.
Une offensive diplomatique américaine tous azimuts
Cet appel à l’unité s’inscrit dans une vaste campagne de séduction menée par Washington auprès des régimes sahéliens, qui multiplie les gestes de rapprochement depuis plusieurs mois.
Au Mali, du 8 au 10 juillet, Rudolph Atallah, directeur adjoint principal pour la lutte contre le terrorisme à la Maison Blanche, a effectué une visite officielle à Bamako. Ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et le ministre de la Sécurité ont porté sur une « coopération rénovée et constructive ».
Les discussions ont abordé la reprise en main sécuritaire par les autorités maliennes, le renforcement des capacités des forces nationales, l’intégration de l’Alliance des États du Sahel dans la lutte antiterroriste, et les accusations de Bamako concernant des soutiens extérieurs aux groupes armés.
Au Burkina Faso, le 27 mai, le Sous-Secrétaire d’État pour l’Afrique de l’Ouest, Will Stevens, a transmis un « message du président Donald Trump » au ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.
Les deux responsables ont évoqué une coopération « solide » et « respectueuse de la souveraineté », reconnaissant les griefs burkinabè concernant les restrictions occidentales sur l’acquisition d’équipements militaires. Stevens s’est engagé à lever ces obstacles.
Depuis Nairobi, le 30 mai, le commandant d’AFRICOM, le général Michael Langley, a adopté un ton plus conciliant, nuançant ses critiques antérieures sur la gestion burkinabè. Il a reconnu la recrudescence des attaques terroristes au Sahel depuis le retrait américain du Niger en 2024, réaffirmant le soutien de Washington à ses partenaires sahéliens et nigérians par le renseignement, la formation et l’appui matériel.
Au Niger, fin avril, le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a rencontré à Washington l’ambassadeur Troy Fitrell pour discuter de la relance des relations bilatérales. Cette approche intervient après que Niamey a dénoncé les accords de défense avec les États-Unis, provoquant le départ progressif des troupes américaines de la base stratégique d’Agadez.
Le déclin français et la montée russe
Cette offensive diplomatique américaine survient dans un contexte de dégradation continue des relations entre Paris et les capitales sahéliennes. Les autorités malienne, burkinabè et nigérienne accusent la France de tentatives de déstabilisation et justifient leur retrait de la Cédéao par ce qu’elles dénoncent comme une instrumentalisation de l’organisation par l’ancienne puissance coloniale.
Parallèlement, ces pays ont considérablement renforcé leurs liens avec Moscou. Dans le domaine sécuritaire, des instructeurs russes ont été déployés dans les trois nations pour assurer la « formation » et appuyer leurs forces dans la lutte antiterroriste, comblant en partie le vide laissé par le départ des forces occidentales.
Une diplomatie américaine à double visage
Malgré ces efforts de rapprochement, Washington maintient certaines mesures punitives. En mars, les États-Unis avaient rouvert partiellement leurs services consulaires à Niamey et réaffirmé leur volonté de renforcement des liens. Cependant, selon le Washington Post, le Niger et le Burkina Faso demeurent inscrits parmi les 25 pays dont les ressortissants risquent de se voir refuser des visas américains, en raison de contentieux liés aux questions migratoires.
Cette situation révèle la complexité de la stratégie américaine dans la région : d’un côté, une offensive diplomatique intense pour reconquérir l’influence perdue ; de l’autre, des sanctions indirectes qui persistent malgré les discours de réconciliation.
Dans un contexte où les régimes sahéliens revendiquent avec force leur autonomie décisionnelle et diversifient leurs partenariats internationaux, la diplomatie américaine navigue entre des objectifs parfois contradictoires : maintenir un engagement sécuritaire dans une région stratégique, afficher un respect de façade pour la souveraineté des États, tout en conservant des leviers de pression diplomatique.
Cette reconfiguration des alliances intervient alors que la France, ancienne puissance tutélaire de la région, voit son influence historique remise en question sur plusieurs théâtres d’opération, ouvrant de nouveaux espaces géopolitiques que les États-Unis et la Russie tentent simultanément d’investir.
AC/Sf/APA