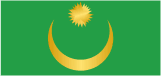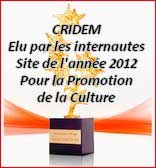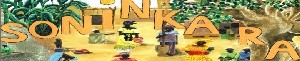18-08-2025 11:54 - Pour un nationalisme positif et fédérateur ! / Par Cheikh BEKAYE

Malgré le calme relatif des relations entre Mauritaniens arabes et négro-mauritaniens, et la latence manifeste de leurs animosités raciales, le sentiment d'appartenance ethnique prédominant ne semblait nullement orienté vers la voie du respect mutuel ni vers l’ouverture à la diversité.
Bien au contraire, le fossé entre les sphères d’influence des deux groupes ethniques se creusait chaque jour davantage. Leurs positions, toujours plus rigides et hermétiques, épousaient une logique identitaire exclusive et un repli communautaire de plus en plus nourri.
Pour entamer cette analyse, je commencerai par les deux principaux pôles de "l’équation politique" actuelle du pays : le pouvoir en place et l’Union des forces démocratiques. Je poursuivrai ensuite par une analyse des mouvements nationalistes extrémistes, d'où qu'ils viennent, ainsi que de leurs actions qui fragilisent et sapent les fondements de l’unité nationale.
Dans cette perspective, je tiendrai à mettre à nu, délibérément, les principales parties impliquées dans l’entretien de la déchirure du tissu social, en désignant chacune d'entre elles par son vrai nom et en leur attribuant, selon mon appréciation, la part de responsabilité qui leur revient dans les erreurs commises concernant le traitement de la question identitaire.
Je garde à l’esprit que mes propos pourraient prêter à confusion. Ainsi, un Arabe ne me connaissant pas pourrait me soupçonner d’adhérer au mouvement "Shou’oubiya", qui prétend à la supériorité des non-Arabes. De même, un Négro-mauritanien, n’ayant entendu que mon nom, pourrait à tort me percevoir comme raciste. Quant au pouvoir, il n’a jamais cessé de m’accabler de son courroux perpétuel.
Parlons d’abord de celui-ci. Mû par les contingences du moment, le pouvoir politique a choisi de mettre un terme à sa confrontation avec la composante négro-africaine de notre peuple. Toutefois, plutôt que de s’atteler à panser les profondes blessures du tissu social, il a préféré tisser des alliances opportunistes et rallier des soutiens tous azimuts, détournant ainsi son regard du cœur du problème : un clivage ethnique déchirant, qui inhibe notre vivre-ensemble. Aucun pas n’a été fait en direction d’une reconnaissance solennelle de l’existence d’une minorité mauritanienne, détentrice de droits légitimes, porteuse de revendications fondées, mais également consciente des devoirs et des limites inhérents à une appartenance commune à la nation.
S’agissant du rassemblement de l'opposition (l'Union des forces démocratiques), il convient de souligner les efforts louables qu’il a déployés pour réunir les Arabes et les Négro-mauritaniens au sein d'un même parti politique. Aussi, à-t-il réussi, du moins au niveau du débat culturel en son sein, à rapprocher les voix dissonantes en tempérant les élans extrémistes des deux camps. Pour ce faire, il a adopté une approche culturelle "composite", plus ou moins raisonnable, mais qui reste un éclat fragile et temporaire.
Le principal reproche adressé à l’Union des forces démocratiques (UFD) tient à son approche étriquée de la question de la négritude, qui tend non seulement à embrouiller les enjeux, mais aussi à accentuer les clivages ethniques au lieu de les apaiser. C’est justement cette approche réductrice qui pousse nombre de ses partisans arabes à adopter une autocritique parfois excessive, allant jusqu’à imputer aux Mauritaniens de même origine les péchés d’un régime qui ne les a ni associés ni consultés, notamment en ce qui concerne sa gestion controversée de l’extrémisme négro-mauritanien.
L’UFD demeure un parti politique qui se targue d’être démocratique, mais qui ne supporte ni ne tolère aucune critique, fût-elle constructive.
Quant aux “faiseurs de flammes” , ces hérauts du nationalisme arabe et chantres d’une négritude exacerbée, ils incarnent une menace plus sourde, mais d’autant plus lourde. Porteurs du ferment de la discorde, ils distillent leur venin identitaire sous les charmes d’une rhétorique enflammée, dont l’éclat peut séduire les foules mais aussi les aveugler. Extrémistes fragiles, vacillant au gré des vents, ils se révèlent aisément manipulables et promptement dressés les uns contre les autres par toute force animée de motivations égoïstes ou d’intérêts volatils, dont les effets, insidieux mais persistants, minent l’unité nationale.
Je suis convaincu que seule l’ouverture d’un dialogue franc, sincère et apaisé entre les nationalistes arabes, débarrassés de tout chauvinisme racial, et les nationalistes négro-mauritaniens, purgés de toute forme d’extrémisme outrancier, peut jeter les bases d’une compréhension mutuelle et d’un vivre-ensemble durable.
Le vrai nationaliste arabe, tel que je le conçois, ne réclame rien qu’il ne soit prêt à offrir, et voit dans l’autre le reflet de ses propres désirs. Il comprend le sens de l'appartenance à une même culture et porte en lui le souffle d’une civilisation commune. Je le rêve comme un groupe humain homogène partageant les mêmes sentiments et les mêmes aspirations, mais qui ressent la douleur de voir l'autre s’arracher aux racines, s’extirper les origines et se fondre dans des rivages civilisationnels qui ne l’ont jamais bercé.
De même, j’imagine le nationaliste négro-mauritanien tout aussi animé par une lucidité profonde, empreint d’une objectivité sereine et mû par une exigence morale comparable. Je le conçois pleinement conscient des effets dévastateurs des blessures culturelles qu’inflige à l’autre, l’effacement des origines et l’osmose forcée dans un univers culturel qui ne reflète ni son histoire ni l’essence de son identité.
On pourrait se demander : où sont donc ces nationalistes extrémistes de tout bord dont j’ai décrié le comportement ? Moi, j’affirme qu’ils existent bel et bien. Ils sont là, présents et identifiables, et c’est à eux de traduire leur nationalisme positif et objectif en actions concrètes qui n’étouffe pas le souffle de l’autre. Faute de quoi, nous serions en droit de nous en détacher, de les considérer comme de vulgaires racistes ou racialistes grotesques. Tous les véritables nationalistes, à travers les vastes contrées du monde, ceux qui respectent l’autre et lui reconnaissent ses droits, les verraient alors comme de simples imposteurs.
Ceux parmi les nationalistes extrémistes qui doutent de la possibilité d’une coexistence pacifique, favorable à l’épanouissement de toutes les composantes de notre peuple, pourraient arguer l’échec de l’expérience du dialogue et de la coopération entre le mouvement nassériste et les Forces de Libération des Africains noirs en Mauritanie (FLAM). Pourtant, le moment le plus glorieux de cette collaboration a été quand des personnes comme Ba Ammar, Ba Omar, Fatimata Mbay, Hamoud Ould Abdi et bien d'autres, vivaient en parfaite harmonie, discutaient sans gêne de toutes les questions nationales, reconnaissaient et respectaient mutuellement leurs différences. Un souvenir marquant est aussi celui où les habitants des villages négro-mauritaniens sortirent pour accueillir un jeune Arabe qui défendait avec passion l’arabisation et l’arabité du pays. Mais ce que rapporte Sow Guilel est sans doute plus touchant et plus impressionnant: après le retrait des étudiants négro-mauritaniens du congrès de l’Union des étudiants en 1986, sa mère leur demanda : « Où avez-vous laissé Hamoud ? ».
Quant à moi, j’ai connu de nombreux visages négro-mauritaniens nobles et bienveillants, lorsque j’ai été, en 1984, l’invité forcé d’un lieu d’abattage humain dans une garnison militaire, où l’on plumait avec zèle les putschistes, les opposants et même des jeunes écoliers…
Après cette épreuve, je ne pourrai jamais me convaincre que le regretté sergent Guissé - qu’Allah l’accueille en Son saint paradis - ainsi que le sergent Lam Abdoullay guettaient mon dernier souffle comme s’il annonçait une nouvelle aurore existentielle, alors que j’agonisais dans une cellule de l’effroyable prison militaire dont ils assuraient parfois la garde. Je me souviens que lorsque j’étais blessé à la cheville par mes tortionnaires, le sergent Lam me portait sur son dos jusqu’aux sanitaires, puis me ramenait, avec une bienveillance silencieuse. Je ne peux aussi oublier les gestes attentionnés du sergent Guissé ni la noblesse discrète du sergent Diop Cheikha.
De la part de ces sous-officiers, mes compagnons nasséristes et moi-même avons bénéficié d’un traitement humain, empreint d’une compassion sincère, en contraste frappant avec l’accueil hostile que nous ont réservé certains militaires d’origine arabe. Ce même élan de chaleur humaine, cette empathie profonde et irrésistible, nous les avons retrouvés chez les policiers négro-mauritaniens, tandis que les agents de police arabes nous traitaient comme si une rancune personnelle, brutale et tenace, les animait contre nous.
De mon côté, alors que je couvrais pour la BBC le procès tenu à la garnison de Jreyda, pour juger des militaires négro-mauritaniens accusés d’avoir tenté un coup d’État en 1987, ma peine atteignit son comble lorsque je découvris parmi les prévenus le sergent Lam Abdoulaye. Ce sous-officier était accusé d’appartenir au FLAM et d’avoir participé à la tentative de coup d’État avorté…
Je n’ai pas pu me retenir d’aller à sa rencontre, et une force irrépressible m’a poussé à le serrer dans mes bras, malgré les hurlements et les remontrances des gardes à mon égard. Pour lui venir en aide, j’ai demandé au colonel, feu Cheikh Ould Boïda, qui présidait le tribunal, de m’autoriser à rencontrer Lam, ce qu’il accepta... Hélas, celui-ci fut condamné à dix ans de travaux forcés.
Après son jugement, je lui ai rendu visite à la prison de Walata et j'ai discuté avec lui, ce qui m'a conforté dans ma conviction que son appartenance à ce mouvement ne signifiait en aucun cas la négation de mon existence, en tant qu’Arabe.
Plus tard, j’ai ressenti un profond apaisement moral et une paix intime s’installer en moi, alors que je me tenais patiemment debout dans un lieu sombre du cinquième arrondissement de Nouakchott, attendant quelqu’un qui viendrait récupérer une pile de lettres que j’avais rapportées de Walata, après que les autorités m’eurent autorisé, en tant que correspondant de presse, à rencontrer les détenus de cette ville, reclus à la suite de la tentative de coup d’État imputée au mouvement FLAM.
Cette aventure périlleuse, je l’ai vécue pour mes frères et compatriotes qui le méritent : Lam, Diop, Moussa, Abdoul Dj, Guissé et tant d’autres. J’ai assumé ce risque au service d’une Mauritanie unie par un profond sentiment d’appartenance nationale, déterminée à panser ses blessures plutôt qu’à les penser avec rancune. Une Mauritanie fière de sa richesse culturelle, où la diversité ne divise pas, mais constitue le ciment fédérateur de notre identité collective.